Communiquer sur la RSE, un cran au dessus
Communiquer la RSE : perspectives et pratiques
L’ouvrage Communicating Corporate Social Responsability: Perspectives and Practice, est dirigé par Ralph Tench, William Sun et Brian Jones. Publié cette année aux Editions Emerald, il s’agit du volume 6 d’une collection « Critical studies on Corporate Responsability, Governance and Sustainability ». ce volume de 430 pages est à ranger aussitôt dans les tous meilleurs ouvrages relatifs à la communication RSE.
Composé de dix-huit chapitres rédigés par des auteurs différents, il conjugue la réflexion originale tout en apportant un très grand nombre de réponses issues de recherches en laboratoires.
Situé au croisement de plusieurs disciplines et bien sûr de celle de la communication et de la RSE, la communication RSE est un domaine qui reste mal perçu et qui demeure en construction ne serait-ce qu’en raison de la difficulté d’une définition partagée de la RSE.
Dans son chapitre « Corporate social responsability communication : towards a phase model of strategic planning », Bernd Lorenz Walter distingue :
- La communication sur la RSE, la RSE comme objet de communication,
- La communication comme partie intégrante de la RSE, dans laquelle il intègre l’écoute des parties prenantes. « Trop souvent la communication fournit des réponses aux questions que personne ne pose, et ne répond pas aux questions qui sont posées. » (p. 63),
- La communication responsable qui concerne les impacts, notamment éthiques, de la communication,
- La communication relative à des produit ou services responsables.
Magnus Fredriksson et Eva-Karin Olsson proposent un modèle d’analyse des discours RSE basé sur leur fréquence, leur étendue et le contexte. Après avoir analysé vingt rapports annuels d’entreprises suédoises, ils observent que « Deux aspects dominent l’information environnementale : qu’avons-nous fait et quand l’avons-nous fait. » A l’inverse, très peu d’informations sont fournies sur les motivations des actions réalisées et le but poursuivi.
Cela rejoint l’étude d’Adrian Zicari sur les tentatives d’harmonisation des référentiels (IIRC, Iso 26000, le Global Compact, GRI) pointant la nécessaire flexibilité des indicateurs en fonction du contexte dans lequel se situent les entreprises et indiquant l’intérêt d’informer également sur les mauvaises nouvelles et les risques.
Tineke Lambooy, Rosemarie Hordijk et Willem Bijveld, dans le chapitre « Communiquer sur l’intégration de la durabilité dans la stratégie corporate », plaident pour la réalisation d’un rapport annuel unique permettant de ne pas déconnecter les enjeux RSE des autres enjeux, notamment financiers, de l’entreprise. Selon eux, dans un rapport intégré, « Il y a davantage d’information compréhensible en lien direct avec la stratégie de l’entreprise » (p. 225). Ils demandent à ce que l’Europe harmonise les législations nationales sur le sujet.
Dans son étude sur la responsabilité des réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google, Theresa Bauer montre bien la difficulté d’une approche globale. Alors que les réseaux sociaux peuvent offrir des plates-formes pour des réseaux activistes, ils procurent également une confidentialité insuffisante des données.
L’étude de Sarah Inauen et Dennis Schoeneborn sur les usages de Twitter par les multinationales et les ONG est véritablement passionnante. Après avoir étudié 3.000 Tweets de trente multinationales et de trente ONG, les auteurs concluent à la quasi-absence de distinction. ONG et multinationales utilisent Twitter de la même manière, c’est-à-dire pour diffuser de l’information de manière unilatérale et donc en échouant à utiliser les possibilités de dialogue offertes par ce réseau social : « En termes de degré d’interactivité, ONG et multinationales utilisent Twitter d’une manière suprenamment similaire» (p. 303).
L’article de Guido Berens et Wybe T. Popma, « Créer la confiance du consommateur dans la communication RSE » est une mine d’or. Les auteurs passent en revue un grand nombre d’études sur le sujet. J’y ai appris que :
- Des allégations précises (comme 100 % biodégradable) procurent de meilleures perceptions que des engagements généraux (comme Earth friendly).
- Lorsqu’une allégation générale (exemple : Ozone friendly) est couplée avec une allégation spécifique (no CFC), l’effet est encore plus important.
- Une allégation qui valorise le consommateur procure plus d’effet qu’une allégation relative à la RSE du produit.
- Une marque voulant convaincre de sa RSE doit d’abord convaincre de la qualité du produit. Le consommateur ne sacrifie pas la qualité contre la RSE.
- Dans certains cas, axer la consommation sur la RSE du produit peut entraîner une baisse de la perception de la qualité de ce produit.
- La communication sur les actions réalisées et les impacts a plus d’efficacité que celle sur les engagements et les programmes.
- Lorsqu’une entreprise communique sur ses actions sans évoquer ses produits, cela n’a pas d’impact sur les intentions d’achat.
- Les consommateurs préfèrent des labels relatifs à des actions uniques plutôt que des labels généraux (mais ce sujet est controversé).
- Les informations RSE sous forme de code couleur (rouge/orange/vert) sont plus efficaces que sous forme numérique
- Les consommateurs n’exprimant pas d’intérêt environnementaux sont plus sensibilisés par des labels négatifs que positifs.
- Lorsqu’une source indépendante valide la démarche RSE, cela entraîne des effets positifs sur l’image de l’entreprise, mais cela peut impliquer la vision d’une simple action de communication.
- Lorsqu’une entreprise a beaucoup communiqué sur la RSE, le fait d’apprendre par les médias des informations négatives à son égard sur le sujet entraîne une perception plus négative que si l’entreprise n’avait pas communiqué sur la RSE.
- Cet effet boomerang ne fonctionne pas lorsque le consommateur s’est déjà forgé l’opinion que l’entreprise aurait une réelle démarche RSE.
Ces deux auteurs concluent par une intéressante réflexion sur les approches de la communication RSE en termes soit déontologiques (l’obligation morale de l’entreprise), soit conséquentialistes (les impacts des activités de l’entreprise). En termes de communication, il n’est pas totalement clair de savoir si le consommateur recherche « une bonne entreprise » (déontologie) ou « un bon produit » (conséquentialisme). L’ensemble des études inclinent toutefois à pencher pour le second.
Un livre indispensable à tous ceux qui s’intéressent à la communication responsable.
Sur le même sujet et sur ce même blog, voir ma critique du livre de Timothy Coombs, cf lien ici: Communiquer sur la RSE, synthèse du livre de T Coombs.
et celle relative au mythe du consommateur éthique: Le mythe du consommateur éthique
En 2011, la revue « Recherches en Communication » a consacré son dossier à la communication environnementale, j’en avais co rédigé l’introduction: Communication & Environnement, actes du colloque « Communicating green ».
Par ailleurs, le N° de Juillet 2014 de la revue « Journal for communicating studies » est également consacré à la communication environnementale. La présentation de ce N° est accessible ici: N° Communication & Environnement du Journal for Communicating Studies




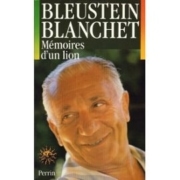


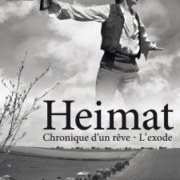
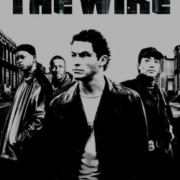
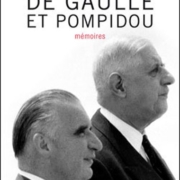



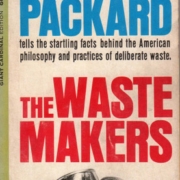
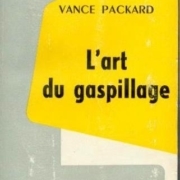
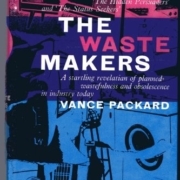
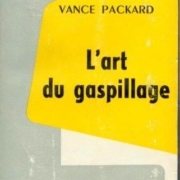

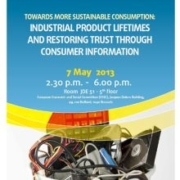
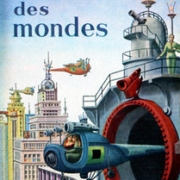



 Auteur de nombreux livres et articles sur l'Europe, la communication, l'environnement et les crises, Thierry Libaert est Conseiller au Comité Economique et Social Européen. Point de contact de la délégation française.
Auteur de nombreux livres et articles sur l'Europe, la communication, l'environnement et les crises, Thierry Libaert est Conseiller au Comité Economique et Social Européen. Point de contact de la délégation française.