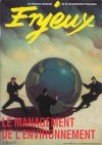 J’ai retrouvé mon premier article publié sur le thème de la communication environnementale, c’était en octobre 1992 dans le revue « Enjeux » publiée par l’Agence Française de Normalisation (AFNOR). Avec le recul, c’est limite affligeant d’optimisme béat, mais ça correspondait sans doute à un moment de ma réflexion et surtout à la naissance de la communication environnementale avant que les problématiques de greenwashing n’apparaissent.
J’ai retrouvé mon premier article publié sur le thème de la communication environnementale, c’était en octobre 1992 dans le revue « Enjeux » publiée par l’Agence Française de Normalisation (AFNOR). Avec le recul, c’est limite affligeant d’optimisme béat, mais ça correspondait sans doute à un moment de ma réflexion et surtout à la naissance de la communication environnementale avant que les problématiques de greenwashing n’apparaissent.
L’article est long (4 pages), il est davantage lisible en téléchargement word sur mon site web, rubrique « articles généraux, bas de page) : https://www.tlibaert.info/communication-generale/
L’entreprise communique sur l’environnement
En quelques années, l’environnement est devenu l’un des premiers territoires de la communication d’entreprise et s’il fallait encore s’en convaincre, il suffirait de feuilleter quelques magazines pour constater l’ampleur de la mutation. Toutes les entreprises font de l’environnement un de leurs thèmes de communication, et non plus seulement les « pollueurs » qui lancèrent le mouvement dans les années 86-87.
On aurait pu imaginer qu’il ne s’agissait que d’une mode et que la valeur verte retomberait rapidement. On sait aujourd’hui qu’il n’en est rien et la plupart des spécialistes en sciences humaines s’accordent à estimer le phénomène profondément durable.
Evidemment cela nécessite des règles et des contrôles. La durabilité ne peut s’acquérir sans la crédibilité. C’est la raison pour laquelle des organismes tels que l’Afnor ou le Bureau de vérification de la publicité jouent des rôles essentiels. En étant le pivot du comité de la marque chargé de la labélisation des produits « verts » et un des acteurs-clé du nouveau label écologique européen, l’Afnor garantit la crédibilité du produit ainsi identifié, évite son utilisation à des fins purement commerciales pour en faire l’indice d’une réelle préoccupation environnementale.
Des causes profondes
Les raisons qui amenèrent les entreprises à se préoccuper d’environnement ne sont pas totalement altruistes. Elles interviennent d’abord en réponse à des demandes extérieures.
C’est d’abord une série de catastrophes qui, sur la période 86-89, furent lourdement ressenties avec les événements de Tchernobyl, de Bâle et l’échouage du super-tanker « Exxon Valdez » au large des côtes de l’Alaska.
Associées à l’émergence de grands problèmes écologiques mondiaux (effet de serre, trou d’ozone, pluies acides, etc.), ces catastrophes amenèrent une prise de conscience : la protection de l’environnement est plus que jamais une question de survie. Il s’agit d’un enjeu planétaire, dont on a pu voir la concrétisation début juin, à Rio, avec le Sommet de la Terre.
Les médias jouent un rôle non négligeable. Pour eux, l’environnement c’est d’abord les problèmes de l’environnement, les risques et le spectaculaire.
L’influence sur les entreprises est très forte : aucune entreprise ne peut accepter d’être en position défensive sous les feux de l’actualité, et pourtant, pour les plus grandes, près d’un article de presse sur cinq les concernant a trait à leur comportement environnemental, soit un accroissement très rapide puisque l’on est passé de 8 % en 1990 à 20 % actuellement.
L’opinion publique n’est pas en reste. L’exigence écologique adressée aux gouvernements est plus forte, et donc la réglementation devient plus sévère. Cela se double d’un enjeu politique, l’environnement devient un objet de surenchères électorales, dont les entreprises peuvent faire les frais. On a pu en voir une traduction récemment avec le problème du redémarrage du surrégénérateur Superphénix où les arguments techniques et économiques ne pesèrent pas lourd face à l’enjeu politique.
Enjeu médiatique et politique, l’environnement représente surtout un enjeu économique pour l’entreprise. C’est parce que le consommateur est prêt à choisir à qualité égale, un produit propre, voire à le payer plus cher, que les entreprises se sont aperçues que l’intégration de la préoccupation environnement dans leur plan stratégique, loin d’être inéluctablement une contrainte, pouvait représenter un avantage concurrentiel de premier ordre. Le marketing de l’écologie était né.
La réalité avant l’éthique
De nombreux discours sont venus expliquer les raisons pour lesquelles les entreprises auraient dorénavant le souci de protéger l’environnement : il y aurait de leur part une volonté d’être une entreprise citoyenne, intégrée socialement, et désirant s’exprimer et agir sur tous les grands sujets contemporains dont l’environnement est un des thèmes-clés. Cette explication d’origine anglo-saxonne qui rejoint les conceptions du « Business Ethics », du moralisme en affaires, et qui ferait de l’environnement le lieu par excellence où la morale pourrait s’exprimer, semble quelque peu démentie par les faits.
Quand des entreprises comme Henkel avec « Le Chat machine » ou Reckitt et Colman avec sa gamme de produits « Maison verte » arrivent à prendre 5 à 6% de parts de marché sur des secteurs aussi difficiles que la lessive ou les nettoyants ménagers, c’est que, peut-être, il y a là une formidable opération de marketing.
Car le produit vert représente un intérêt considérable pour l’entreprise : il valorise son client. En achetant un produit écologique, le consommateur se prouve qu’il n’est pas qu’un consommateur mais qu’il agit également, à son niveau, pour la protection de l’environnement. C’est ce que traduit l’adage américain « Be a part of the solution ».
Déjà en France plus d’un consommateur sur deux déclare prendre en considération la protection de l’environnement lorsqu’il effectue ses courses (et quatre sur cinq en Allemagne). C’est peut-être l’une des plus grandes réussites de la communication verte que de pouvoir transformer la contrainte de l’achat en un élément d’auto-valorisation.
La communication verte : une panacée ?
Le consommateur n’est pas le seul gagnant au jeu de la communication verte. L’entreprise peut gagner deux fois : d’abord en aval de sa production avec l’attrait pour les produits « verts », mais aussi en amont par la réduction de matières premières ou de produits d’emballage pouvant apparaître inutiles.
Là aussi, la communication est indispensable car un packaging peu attrayant pourrait signifier une médiocre qualité du produit, alors qu’il peut apparaître comme un signe supplémentaire de l’attention que l’entreprise porte à l’environnement, et notamment à la réduction des déchets.
Le management interne de l’entreprise peut gagner également. Quel plus merveilleux sujet de mobilisation du personnel que la sauvegarde de l’environnement ! Peut-on imaginer meilleur thème de consensus et de cohésion interne ? Le sentiment d’appartenance à l’entreprise en est renforcé. Conscient de travailler pour la rentabilité de l’entreprise, mais aussi pour des valeurs qui la transcendent et la dépassent, le salarié trouvera dans son travail une motivation nouvelle.
L’environnement peut être considéré comme un élément de la politique de ressources humaines. C’est un thème qui peut recueillir l’assentiment général des salariés. Qui, dans l’entreprise, pourrait s’opposer à une action en faveur de l’environnement ? Chaque entreprise peut recourir à un management vert, chaque secteur de son activité peut être concerné et chaque employé peut en retirer un avantage. Ainsi, ce n’est pas un hasard si, en 1991, la fusion entre la Lyonnaise des Eaux et le groupe Dumez s’est réalisée sur le thème « être au service de la cité et de l’environnement ».
Le management vert se révèle l’un des moyens les plus efficaces pour développer dans l’entreprise la recherche de la qualité, par opposition au gaspillage. Thème mobilisateur, d’application immédiate, il peut réduire les dépenses internes et ses répercussions sur l’environnement sont facilement chiffrables. C’est ce qu’illustre l’exemple de l’entreprise Sandoz qui, après l’accident du 1er novembre 1986 à Bâle, a établi une charte en dix points, déclarant en un article premier que la protection de l’environnement est une des priorités de Sandoz et que, pour cela, chacun est concerné.
Les associations écologistes ne sont pas exclues. Avec le développement des actions de mécénat envers l’environnement qui concerne actuellement près d’une entreprise sur trois, la plupart des principales associations comme le WWF, les Amis de la Terre ou la Frapna peuvent bénéficier de sommes importantes pour la réalisation d’opérations de sensibilisation ou de sauvegarde.
Le mécénat pour l’environnement est un domaine si vaste qu’il permet un très grand nombre d’applications.
L’eau, premier sujet de préoccupation écologique pour 53 % des français est le domaine de prédilection des lessiviers et des assainisseurs. Ainsi, Procter et Gamble a signé une convention de parrainage ave le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
En revanche le thème de l’air est délaissé par les actions de mécénat. Les choix y sont réduits (participations à des programmes de recherche pour la qualité de l’air) et les résultats ne sont pas spectaculaires. Il n’est pas facile d’exploiter médiatiquement une opération non visuelle !
Le thème de la faune présente deux avantages majeurs. D’une part, il permet un suivi des actions engagées. La protection d’une espèce est une action qui s’inscrit dans la durée, le système du baguage ou la pose de balises sur certains animaux n’ont d’effet mesurable qu’à long terme. Et d’une année sur l’autre, l’entreprise peut tirer avantage des résultats déjà acquis.
L’animal menacé véhicule un contenu affectif et émotionnel intense dont bénéficie l’entreprise sponsor. Les entreprises qui ont pour emblème un animal y trouvent un intérêt particulier. Ainsi, le chocolatier Côte d’Or s’est lancé en partenariat avec le WWF dans un ambitieux programme de sauvegarde de l’éléphant, son emblème.
Le paysage et le patrimoine sont les lieux privilégiés des entreprises de services ou des entreprises industrielles de grande taille avec un thème dominant : la protection de la forêt. Les actions sont alors préventives telles que la lutte contre les incendies, (acquisition par Thomson d’un hélicoptère bombardier d’eau, sponsorisation des casques verts du Var par TDF) ou curatives, comme c’est le cas pour le reboisement.
Ce dernier domaine illustre parfaitement la nécessité de règles. L’entreprise doit définir une stratégie : veut-elle participer à une action à long terme, en liaison avec des associations écologiques (comme Bull qui a lancé, à l’occasion du 10ème Congrès forestier mondial, un vaste programme, Arbor, en liaison avec le WWF et l’ASE pour mettre en place une base de données multi-médias sur l’arbre) ? Ou veut-elle simplement lier son nom à une opération médiatique ponctuelle ? Tout en sachant, d’une part, qu’il s’agit d’une action fragile ; un nouvel incendie peut annihiler une action de reboisement. Et d’autre part, que ce domaine est très encombré : les sponsors sont nombreux. Le bénéfice d’image qu’en retire une entreprise en est morcelé et donc réduit.
Excepté ces cas avec la communication verte, tout le monde, à commencer par l’environnement lui-même, peut y gagner. Certes non, et aucune entreprise n’acceptera d’associer son image à la protection de l’araignée à croix jaune ou à celle du crapaud baveux, espèces animales pourtant fort utiles. On signalera seulement que ce n’est pas à l’entreprise de se préoccuper prioritairement de la protection des animaux, et que si certaines espèces comme la loutre ou l’ours des Pyrénées, peuvent bénéficier de leurs investissements, ce sera déjà un progrès décisif.
Pour un scepticisme constructif
A constater globalement, la vague écologique semble n’avoir que des effets positifs, chaque partie prenante en retire un avantage.
Pour que la cause de l’environnement progresse réellement, il faut toutefois éviter les idées préconçues et un certain manichéisme. C’est ainsi que le public a souvent tendance à considérer l’entreprise comme la source de toutes les pollutions et l’association écologique comme les sauveurs de l’humanité future. De fait, dans tout conflit les opposant, l’entreprise apparaîtra comme défendant ses intérêts propres, c’est-à-dire purement financiers, alors que l’association sera perçue comme défendant un intérêt objectif, généreux. Sans évidemment dénier un rôle fondamental aux associations, force est toutefois de constater que nombre d’entre elles se conduisent comme de véritables industries et refusent parfois tout partenariat constructif. Ceci afin de permettre une cohésion interne et un développement du nombre d’adhérents orienté sur des batailles gagnées d’avance envers des entreprises boucs émissaires.
Il faut aussi garder un regard critique. L’environnement n’est plus seulement un exutoire pour doux rêveurs, il est devenu un élément-clé d’une guerre commerciale sans merci, à l’échelle mondiale. Si le pot catalytique est généralisé dans l’ensemble des communautés européennes, ce sera grâce à un formidable travail de lobbying allemand soutenu par une industrie automobile déjà équipée. L’imposition d’un catalyseur sur un modèle allemand n’a que peu d’effet sur le prix relatif de l’automobile, étant donnée la consistance de ce parc composé majoritairement de grosses cylindrées (BMW, Mercedes, etc.). A l’inverse c’est un rude coût pour le parc automobile européen spécialisé en petites cylindrées. L’intérêt commercial est d‘ailleurs évident car dans le même temps où l’Allemagne prenait argument des pluies acides pour généraliser les catalyseurs, elle refusait de limiter la vitesse de circulation sur ses autoroutes, ce qui eut été un moyen tout aussi efficace pour la protection de l’atmosphère.
Il faut observer et se méfier des discours. Ce n’est peut-être pas un hasard si l’homme est le grand absent de toute la communication environnement, les publicités ne présentent que de superbes paysages, parfois des visions catastrophiques de zones polluées, mais d’hommes jamais. Ceci peut apparaître amusant, c’est fondamental. A la base du renouveau écologique, on distingue une tendance appelée « deep ecology » qui milite pour la reconnaissance de droits naturels qui seraient conférés aux divers éléments de notre environnement : l’homme n’est qu’une partie de la nature et n’aurait pas davantage de droits que les animaux ou les arbres. La nature est première, l’homme vient ensuite. Cette tendance est extrêmement forte aux Etats-Unis, et commence à se répandre en Europe. La communication verte doit éviter d’aller dans cette voie antihumaniste car elle aborderait ses propres fondements.







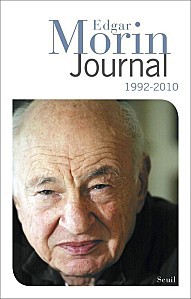
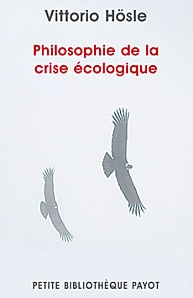
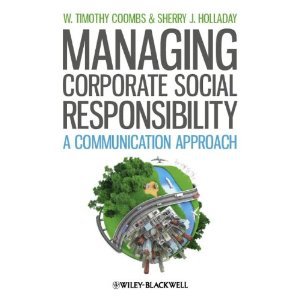


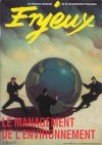
 Auteur de nombreux livres et articles sur l'Europe, la communication, l'environnement et les crises, Thierry Libaert est Conseiller au Comité Economique et Social Européen. Point de contact de la délégation française.
Auteur de nombreux livres et articles sur l'Europe, la communication, l'environnement et les crises, Thierry Libaert est Conseiller au Comité Economique et Social Européen. Point de contact de la délégation française.